Coups
d’Etat en Afrique : faits attendus, légitimité ou pétition de
principe ?
A la lueur du dernier
coup d’Etat en Afrique, le jeudi 18 Juin 2010 à 13H00 à Niamey au Niger, la
question se pose. Dans un passé récent,
Pour saisir
le sens du terme et le pourquoi de la pratique et le recours, nous ressortons
deux documents d’archives et un d’actualité qui pourraient nous éclairer.
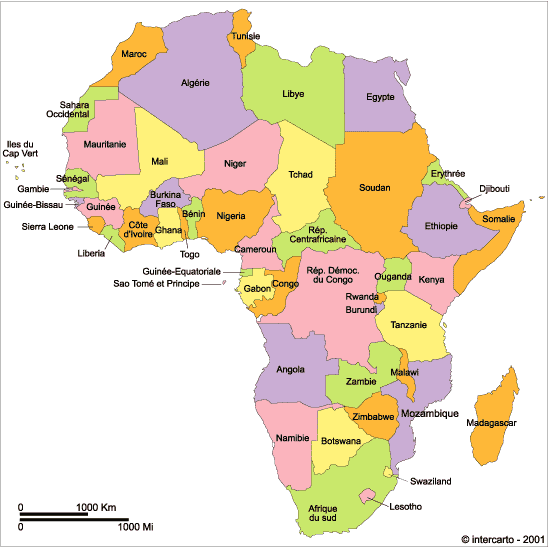
1. Réflexion sur la
notion de Coup d'État comme forme d'action politique à la lumière de la
tentative du 28 mai en Centrafrique
2. Désintégration des souverainetés
nationales : Pourquoi tous ces coups d’Etat en
Afrique ?
3.
Niger, un coup d’Etat de plus pour l’Afrique
Trois mois après la malheureuse
tentative de Coup d'État survenue en République centrafricaine en date du 28 mai
2001 et la répression (opération de ratissage) qui s'en est suivie avec un bilan
en vie humaine d'une ampleur sans précédent de part et d'autres des camps des
auteurs de la conjuration ou des forces loyalistes, il importe de nous
interroger sur le phénomène des Coups d'État.
En effet, alors que d'autres rumeurs
de tentatives de Coups d'Etat supposées ou réelles se font jour ; que la
pratique de l 'ostracisme semble s'ériger en règle ; au moment où les
commentaires et les récupérations à visée tribaliste que l'on peut observer ici
ou là vont bon train ou que les conditionnements moraux de la population par les
élites de notre nation continuent de mettre en exergue la fragilité du tissu
national et les limites de la conscience nationale, il nous apparaît nécessaire
de soumettre à la réflexion collective la problématique des Coups d'État et sa
pratique comme forme d'action politique.
Une réflexion théorique sur la
notion s'impose en effet, tant les Coups d'État, étant donné leur régularité en
notre pays, tendent de plus en plus à s'ériger en modèle de gouvernement ou en
mode normal d'accession à la magistrature suprême lorsque l'on s'oppose au
pouvoir institué.
Elle s'avère nécessaire aussi, parce
que les galimatias de nos hommes politiques et autres intellectuels,
détenteurs de potentiel de savoir certes mais peu souvent teintés de culture
politique, dénaturent l'idéal démocratique.
Elle devient une exigence parce que
ces cadres qui dirigent notre Nation, à l'exception d'une minorité, au nom d'un
profond attachement à la pratique politique n'éprouvent que peu d'intérêt pour
les théories qui la sous tendent, alors même qu'il est universellement admis
qu'une pratique sans théorie est forcément aveugle.
Elle serait d'une certaine utilité
enfin, parce que ces personnalités, dont les propos ou les écrits extrémistes
dépassent souvent l'entendement de tout être doué de conscience et de raison,
n'apportent que peu d'éclairage au débat public.
Aussi, l'analyse, dont l'objectif
est de dire s'il est légitime ou non d'avoir recours aux Coups d'État comme
forme d'action politique, s'attachera à démontrer s'ils sont porteurs ou non de
considérations politiques, ou au contraire, à dire s'il convient de les
stigmatiser les Coups d'État comme une forme baroque de l'action
politique.
Cela revient à se poser la question
de savoir s'il y a ou non des considérations politiques dans les Coups d'État
?
La réponse à cette question aussi
trivialement posée suppose, au préalable, que l'on précise la notion même de
Coup d'État galvaudée ici ou là par les thuriféraires, généralement des
militaires mais parfois aussi des civils, de ce mode d'action politique, ou au
contraire, sévèrement blâmée, à juste raison d'ailleurs, par les zélateurs ou
les partisans d'un mode démocratique de dévolution du pouvoir qui est celui de
la voie des urnes.
Une série d'approches contemporaines
tendent à considérer les Coups d'État comme une forme baroque de l'action
politique alors qu'un certain nombre d'auteurs essentiellement classiques et non
des moindres l'ont élevé au rang d'actions hardies devant être menées par les
politiques.
Aussi, convient-il de les
passer en revue respectivement.
En reprenant une définition d'un
dictionnaire usuel du français, notamment celui de la maison Hachette,
l'on verra que celui-ci définit les Coups d'État comme " une action
illégale, souvent violente, par laquelle un gouvernement est
renversé ".
Le Grand ROBERT définit le concept presque de la
même manière en l'assimilant à " une manœuvre politique souvent violente
destinée à prendre le pouvoir ".
Madeleine GRAWITZ dans son
lexique des sciences sociales considère le Coup d'État comme " un
terme ambigu utilisé pour qualifier une tentative de prise de pouvoir par une
minorité en dehors des règles constitutionnelles et sans participation massive
de la population... ".
Rapportées à la situation ayant
prévalu dans notre pays le 28 mai dernier, l'on remarquera une certaine
correspondance entre la tentative du 28 mai et les définitions susmentionnées à
la différence que, s'agissant de la première acception, l'action des auteurs du
Coup d'État du 28 mai était dirigée non pas contre le gouvernement de
L'on remarquera aussi que toutes
considèrent le Coup d'État comme une action illégale, violente, irrégulière,
bref comme une forme baroque de l'action politique.
L'on peut légitimement penser que
telle est la conception contemporaine de la notion, laquelle a pu conduire
certains auteurs, à l'exemple de Francis FUKUYAMA ( in La fin de l'histoire
et le dernier homme), à affirmer " qu'un consensus remarquable semblait
apparu ces dernières années concernant la démocratie libérale comme système de
gouvernement ".
Il se trouve cependant qu'à coté de
cette conception dominante plutôt hostile au Coup d'État comme forme d'action
politique il en existe une, minoritaire il est vrai mais très classique, qui
élève le Coup d'État au rang d'action politique des plus
nobles.
A l'origine, les Coups
d'État constituaient une forme noble de l'action
politique.
Ils se pratiquaient à la
création des États ou pour leur conservation. L'antiquité gréco-romaine nous en
donne nombre d'illustrations :
C'est ainsi que, parlant des Coups
d'État, CICERON Marcus Tullus (106-43 av. J.-C.) qui, après avoir déjoué la
conjuration de Lucius Sergius CATILINA (108-62 av. J.-C.) et fait exécuter ses
complices, pouvait-il affirmer : " L'abandon de l'utilité commune est
contre nature... ; ...que celui qui pourvoit au bien et à la société des hommes
fait toujours son devoir... ; ...la conservation du peuple doit être la loi
souveraine dans toutes les actions ".
Mais ARISTOTE (384-322 av. J.-C.),
avant CICERON, avait lui aussi entrevu la question lorsqu'il faisait le constat
du fait que " d'une part le monde est fait d'artifices et de malices et que
d'autre part on renverse les royaumes par le moyen de fraudes et de finesses et
qu'il ne serait pas plus mal de les défendre par les mêmes
moyens ".
Cependant, c'est Gabriel NAUDE
(philosophe athée français 1600-1650) qui donnera une définition beaucoup plus
précise de la notion en décrivant les Coups d'État comme " un ensemble
d'actions hardies et extraordinaires que les princes sont contraints d'exécuter
aux affaires difficiles et comme désespérées, contre le droit commun, sans
garder même aucun ordre ni forme de justice, hasardant l'intérêt du particulier
pour le bien public ".
Cette pensée largement inspirée par
les théories Machiavéliennes du pouvoir paraît être la plus communément admise
chez les classiques qui ont, peu ou prou, élevé les Coups d'État au rang
d'actions nobles, hardies, courageuses et extraordinaires devant être menées par
les princes pour le bien public.
On peut noter aux travers de ces
approches que les Coups d'État peuvent être aussi bien l'œuvre des acteurs d'un
régime que de ses opposants ou adversaires.
Qu'ils nécessitent pour leur
exécution l'usage de la ruse, du mensonge ou de la
violence.
Mais si l'on peut s'apercevoir, à
l'analyse, que la tentative de Coup d'État du 28 mai dernier en Centrafrique
peut aisément épouser la notion de Coup d'État telle qu'entendue dans son
acception contemporaine, en tant qu'action illégale, irrégulière, en tant que
coup porté contre l'État, l'on ne peut ne pas s'empêcher de stigmatiser les
représailles ou "opération de ratissage" comme étant également des Coups d'État
au sens classique de la notion, au sens d'actions extraordinaires accomplies
pour la préservation des intérêts du régime en place.
Et, c'est là que la citation
d'ARISTOTE susmentionnée trouve toute sa plénitude : " ...on renverse
les royaumes par le moyen de fraudes et de finesses et qu'il ne serait pas plus
mal de les défendre par les mêmes moyens ...".
Sémantiquement parlant, autant les
auteurs du Coup de force du 28 mai en portant un coup à l'État avec l'attaque
aux roquettes et autres armes lourdes de la résidence du chef de l'État ont
perpétré un Coup d'État, autant, avec les attaques aux roquettes, hélicoptères
et autres armes lourdes des quartiers réputés favorables aux conjurés, le
régime, fort du soutien extérieur qu'il a pu avoir, en a perpétré un
autre.
L'important est ici de mettre en
exergue les considérations politiques susceptibles de sous-tendre la tentative
du 28 mai 2001 en Centrafrique.
II- Les
Considérations Politiques dans la tentative du 28 mai
2001
L'on part du postulat selon lequel
le Pouvoir demande toujours le respect. C'est la résurgence, sur le terrain
politique, de certains préceptes bibliques.
En effet, l'Apôtre Pierre dans sa
première Épître (Chapitre II verset 13-15) disait : " ... Soyez soumis à
cause du seigneur à toute institution humaine, soit au Roi comme souverain, soit
aux gouvernants... ".
L'Apôtre Paul également, dans son
Épître aux Romains (Chapitre XIII verset 1), affirmait que : " ... Toute
personne soit soumise aux autorités supérieures ; car il n'y a point d'autorité
qui ne vienne de Dieu... ".
Autrement dit, les deux Apôtres
admettent que chacun se soumette aux autorités en charge.
Mais, Saint-Thomas d'AQUIN
(1228-1274) d'abord, à la question 42 de sa Somme contre les gentils,
reprenant les critiques de Saint-Augustin (354-430) qui admettait déjà au Vème
siècle dans
John LOCKE (1632-1704) ensuite, dans
son Traités de gouvernement civil dira que : " ... La violation du
contrat social par le prince dispense les sujets
d'obéissance... ".
Et Benjamin CONSTANT (1767-1804)
d'ajouter : " ... Les citoyens possèdent des droits individuels
indépendants de toute autorité sociale ou politique, et toute autorité qui viole
ces droits devient illégitime... ".
Ces discours veulent dire, en
filigrane, que si le pouvoir légitimement institué doit nécessairement demander
le respect, il en est autrement lorsque l'utilité publique, l'intérêt public ou
général ne semble plus être le leitmotiv de son action.
C'est pourquoi, à l'analyse de
l'actualité internationale en général et des pays en développement en
particulier, notamment africains, l'on peut s'apercevoir que certains Coups
d'État peuvent avoir un assentiment populaire ou, au contraire, subir une
désapprobation populaire.
Cela signifie que les Coups d'État
peuvent être potentiellement porteurs de considérations politiques lesquelles
peuvent entraîner ou non leur légitimation a posteriori par la
population.
En serait-il le cas pour le coup de
force survenu en Centrafrique en date du 28 mai 2001 ?
Autrement dit, la tentative du 28
mai peut-elle revendiquer comme mobile de son action l'utilité publique ? Telle
est la question à laquelle nous tenterons de répondre en dernière
analyse.
Nous verrons qu'un certain nombre de
facteurs militerait en faveur d'une réponse positive alors qu'une série
d'éléments non négligeables, au demeurant, optent pour une réponse
négative.
Les approches
structuro-fonctionnalistes du phénomène politique nous apprennent que, de par sa
nature de système social distinct des autres, la vie politique doit être
interprétée comme soumise aux influences qui résultent des autres parmi lesquels
elle est insérée dans la réalité.
Que de l'environnement culturel,
économique, religieux, etc., le système politique reçoit des demandes sous forme
d'exigences qu'il doit réguler, transformer en des réponses positives qui
peuvent être des décisions obligatoires ou des actions.
Que le système politique fonctionne
comme un ensemble d'interactions avec son environnement.
Qu'il a pour fonction de convertir
les intérêts, en les formulant et en les agrégeant.
Ainsi, la pérennité du système se
mesure à sa capacité à transcrire en des actes positifs les demandes de la
société globale. Autrement, l'on assisterait à un blocage, à des crises
susceptibles d'entraîner la mort du système. Soit par une fin légale à travers
une censure démocratique populaire soit, par une fin illégale, irrégulière aux
travers des putschs ou autres formes de pronunciamiento et soulèvements
populaires comme une révolution.
Aussi, comme tout système politique
au monde, la société politique centrafricaine est une société au second degré
car issue de la société globale du fait des élections.
Ce système a des fonctions dont
l'accomplissement satisfaisant pouvait lui garantir une certaine
pérennité.
Parmi ces fonctions, figure celle de
la satisfaction des demandes sociales de la communauté centrafricaine exposées
sous forme d'exigences.
Il s'agissait, entre autres, de
demandes relativement au règlement des traitements des fonctionnaires
centrafricains ; au règlement pensions des personnes qui ont passé toute leur
vie au service de l'État centrafricain, c'est à dire les fonctionnaires
aujourd'hui à la retraite ; au règlement des bourses des étudiants qui
représentent l'avenir de notre pays.
Il s'agissait, par ailleurs de
demandes relativement à un système de santé convenable, à une meilleure
éducation de la jeunesse, à une justice équitable pour tous, à la sécurité
publique et à la paix sociale...
Ces exigences de la société
centrafricaine n'ont pas reçu de réponses satisfaisantes de la part du système
politique.
Et, comme disait CICERON : "...
celui qui pourvoit au bien et à la société des hommes fait toujours son
devoir... ; ... la conservation du peuple doit être la loi souveraine dans
toutes les actions".
Et si ce n'était la personnalité de
l'instigateur de la tentative du 28 mai 2001, les nécessités démocratiques et de
paix sociale, un assentiment populaire eût été possible. Somme toute, autant
d'arguments susceptibles de vider la tentative du 28 mai de toutes
considérations politiques qu'il convient d'analyser
maintenant.
En premier chef il y a les
nécessités démocratiques :
Aujourd'hui, il semble qu'il existe
une sorte de consensus au sein de la population centrafricaine sur la question
du mode de dévolution démocratique du pouvoir.
Il apparaît, à l'observation de la
communauté centrafricaine aujourd'hui, que l'on ne puisse plus revenir sur le
principe selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple qui
l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct et par la voie
du référendum.
Ce principe qui admet aussi,
qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice,
semble être unanimement partagé en Centrafrique.
D'où la condamnation de la tentative
du 28 mai 2001 tant par toute la classe politique centrafricaine que par une
frange importante de la population.
Le peu de soutien de la population
aux auteurs du putsch semble démontrer un nouvel état d'esprit de la population
centrafricaine et semble être révélateur du fait que l'opinion publique
centrafricaine ne serait plus disposée, et c'est bien d'ailleurs, à accepter que
l'on utilise la force pour parvenir au pouvoir.
En second lieu, il y a les
nécessités de paix sociale, condition sine qua none de développement
économique et social.
Elles sont en effet de nature à
atténuer notablement les considérations politiques dans la tentative du 28 mai
2001.
Car pour citer à nouveau Saint
Thomas D'AQUIN : "... le renversement d'un régime tyrannique n'a pas le
caractère de sédition, hors le cas où le renversement se ferait avec tant de
désordre qu'il entraînerait pour le peuple plus de dommage que la tyrannie
elle-même...".
Au mieux, la tentative du 28 mai
n'aurait pu avoir comme résultat que le renforcement du classement de notre pays
parmi les pays les plus instables politiquement au regard de la théorie dite de
"Risque-pays".
Surtout dans la mesure où les
négociations entre les institutions financières internationales et notre pays
semblaient trouver un aboutissement la veille de cette
tentative.
Il y a enfin la personnalité du
principal instigateur de la tentative lui-même qui pose
problème.
Notamment, La circonstance qu'il ait
déjà été pendant plus d'une dizaine à la tête de l'État centrafricain sans pour
autant qu'il y ait une prospérité économique et sociale, semble vider
notablement la tentative du 28 mai 2001 de toutes considérations
politiques.
En dernière analyse, l'on pourrait
dire que si la tentative de Coup d'État du 28 mai 2001 est condamnable par tout
être attaché aux principes inhérents à la dévolution démocratique du pouvoir, il
n'en demeure pas qu'il ne soit totalement dénué de toutes considérations
politiques.
Aussi, il importe de rappeler à nos
dirigeants "démocratiquement élus" qu'il leur faudrait gouverner en SOLON plutôt
qu'en PISISTRATE, TARQUIN ou SYLLA.
Patrick-Emery
NGUEREMBASSA
(Diplômé d'études supérieures de Sciences politique, Doctorant en droit.),
Source : Sangonet.com, 2001
Actuellement Consultant, Intervenant Master 2 Institut de la communication Université Lumière Lyon 2
2. Désintégration des
souverainetés nationales : Pourquoi tous ces coups d’Etat en
Afrique ?
Source :
monde-diplomatique.fr - Janvier 2004 -par Pierre Franklin
Tavares
L’Afrique subit avec une acuité
particulière les déstabilisations politiques et sociales dues à la
mondialisation. En effet, déjà fragiles, les jeunes Etats indépendants ont
hérité d’une souveraineté chancelante que la domination des multinationales et
la dislocation des sociétés sous l’effet des politiques d’ajustement structurel
ont achevé de réduire à néant. Ainsi, la puissance publique devient une fiction
dont on cherche à tirer profit et le coup d’Etat un mode naturel de conquête du
pouvoir.
Coups d’Etat en Guinée-Bissau
(septembre 2003) et à Sao-Tomé- et-Principe (juillet 2003), tentatives
de putsch au Burkina Faso et en Mauritanie (octobre 2003), renversement de
M. Charles Taylor par une rébellion au Liberia (août 2003), remous
politiques au Sénégal (année 2003), déstabilisation de
Les crises actuelles apparaissent
d’une tout autre nature que celles qui affectaient les Etats africains dans les
années qui ont suivi les indépendances. Aux luttes idéologiques de la guerre
froide ont succédé une double déstabilisation en raison de l’insertion à marche
forcée dans la mondialisation économique, d’une part, et, d’autre part, de la
démocratisation improvisée d’Etats sans moyens. Ces deux phénomènes ont abouti à
délégitimer les constructions nationales naissantes et à rendre purement fictive
la souveraineté de ces pays.
Par une « ironie
tragique », plusieurs phénomènes de nature très différente ont conjugué
leurs effets déstabilisateurs : la fin de l’affrontement Est-Ouest, qui
structurait la géopolitique africaine ; l’improvisation par les bailleurs
de fonds d’une injonction démocratique mal maîtrisée (relayée par le discours de
François Mitterrand à
Tous les indicateurs
macroéconomiques, sociaux et sanitaires se sont dégradés depuis les années 1980,
éradiquant les classes moyennes et suscitant de profondes tensions sociales.
L’Afrique de l’Ouest s’est appauvrie : tous les produits intérieurs bruts
se sont détériorés, la croissance promise par les bailleurs de fonds n’est pas
au rendez-vous : elle est même passée de 3,5 % en moyenne en 1975 à
2 % en 2000 (4). Le Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) fait état d’une « dégradation sans précédent » des
indicateurs de développement humain (5).
Presque partout les salaires de la
fonction publique sont versés avec difficulté : en Centrafrique, au
printemps 2003, l’une des premières mesures du gouvernement putschiste du
général François Bozizé sera d’annoncer le paiement des traitements en retard.
Le chômage ne cesse de croître. Les pathologies (sida, maladies
tropicales, etc.) se propagent et affectent gravement l’espérance de vie
des populations. Les réfugiés se dénombrent par milliers. Paupérisées, les
armées sont devenues une menace constante pour les régimes de nombreux pays,
comme le montrent le putsch en Centrafrique, la tentative de coup d’Etat au
Burkina Faso et la rébellion de Côte d’Ivoire (6).
De fait, ne se sont
« démocratisés » que les coups d’Etat et les guerres civiles
entremêlées d’étranges guerres étrangères qui forment à présent un écheveau
dense et difficile à démêler. Ainsi, le Congo Kinshasa est à la fois envahi par
ses voisins et divisé entre différentes factions politiques, elles-mêmes
soutenues par des puissances étrangères (7). Tout se passe comme s’il n’y
avait plus de « vie éthique » en Afrique. Il est très révélateur que
la notion même de « bien public » ait disparu des discours politiques
et intellectuels.
En lieu et place de toute volonté
générale, il n’y a plus qu’un affrontement généralisé de volontés singulières,
toutes focalisées sur les ethnies, ces leviers si faciles à manipuler, comme le
montrent la thématique de l’« ivoirité » et la propagande des acteurs
de la crise en Côte d’Ivoire.
La nécessité, disent les
philosophes, est l’ensemble des accidents. Ainsi, il existe une
continuité politique et historique entre les guerres et les coups d’Etat depuis
une quinzaine d’années. En réalité, de Monrovia à Bissau, de Freetown à
Nouakchott, de Dakar à Niamey, de
D’une part, l’existence et le
fonctionnement de chaque Etat d’Afrique de l’Ouest sont directement dépendants
des calculs des Etats voisins : répercussion régionale de l’instabilité de
D’autre part, le droit public
interne –
La crise ivoirienne en est une
illustration significative. En effet,
Or, en Côte d’Ivoire, l’institution
présidentielle ne peut être remplacée par une primature aux pleins pouvoirs, le
pays n’ayant pas encore un régime parlementaire comme en a, par exemple, le
Cap-Vert. Pour les Ivoiriens, un droit public externe excellent vaut moins qu’un
droit public interne défectueux. Evidemment, ces contradictions expliquent sans
les justifier les changements de position du président Laurent Gbagbo (lire
Poker menteur en Côte
d’Ivoire).
L’incurie des élites africaines
achève par ailleurs de réduire à néant les souverainetés. Un délégué au Dialogue
national centrafricain, organisé après le putsch du printemps
En une quinzaine d’années, les
frontières dessinées par la conférence de Berlin (1885) et consacrées par les
textes fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) sont toutes
devenues poreuses et fictives. Elles sont de véritables passoires pour tous les
mouvements rebelles : en Côte d’Ivoire, des milices et des mercenaires
recrutés par les différents camps sont devenus quasi incontrôlables et menacent
de dérives mafieuses certaines parties du pays. Le même phénomène peut être
observé au Liberia, où des anciens combattants de la guerre de Sierra Leone se
sont reconvertis dans la lutte contre le président Charles Taylor, déchu au mois
d’août 2003.
La forte interdépendance des Etats
africains dépend elle-même, et pour beaucoup, des intérêts des multinationales.
Ces dernières, qu’elles soient européennes ou orientales, ont soumis et dompté
les appareils d’Etat. Elles ont de facto aboli les frontières héritées de la
colonisation et ont profondément modifié la nature des Etats du continent, en en
faisant des annexes ou des bureaux de contrôle.
Les conflits « ethniques »
ne sont souvent que le paravent des calculs d’intérêt effectués par les pouvoirs
en place ou des multinationales. Ces derniers instrumentent des conflits
régionaux ou locaux pour obtenir ou conserver des marchés et des concessions. Le
rôle des industriels du bois dans la décomposition du Liberia et du
Congo-Kinshasa a ainsi été dénoncé par des organisations non gouvernementales et
un rapport des Nations unies (9). La presse ivoirienne ne manque jamais une
occasion de rappeler que la crise du pays est née lorsque le président Gbagbo a
annoncé la renégociation de certains marchés
publics (10).
Cette immixtion des multinationales
– comme des règles de la mondialisation économique – dans la sphère
publique africaine a provoqué un amalgame entre droit public et droit privé. En
effet, la chose publique n’est pas gérée conformément aux règles universelles de
l’administration publique, mais selon les règles juridiques du droit privé. La
plupart des chefs d’Etat africains ne se pensent pas comme des présidents de
La gestion de la manne pétrolière au
Gabon et en Angola en est une parfaite illustration. Les privatisations
ordonnées par les bailleurs de fonds ont donné lieu à de véritables bradages
auxquels les Etats n’ont pas voulu, ou pas pu, résister. Ainsi, le gouvernement
sénégalais n’en finit-il pas de renégocier les conditions de la privatisation de
Une recolonisation
civile
Depuis la fin de l’affrontement
Est-Ouest, les multinationales agissent de plus en plus sans contrepoids
politiques (11). Liées, à l’origine, aux intérêts gouvernementaux,
elles acquièrent une certaine autonomie. En Afrique, où les Etats sont faibles,
elles ont littéralement fait de la politique étrangère en mettant à profit le
désengagement rapide – dicté par le refus d’ingérence dans les affaires
intérieures – des pays européens. Le procès des dirigeants de la société Elf a
révélé les négociations organisées par M. Loïk Le Floch-Prigent avec la
rébellion angolaise (Union pour l’indépendance totale de l’Angola - Unita) de
Jonas Savimbi, tandis qu’il finançait officiellement le pouvoir en place
(Mouvement populaire de libération de l’Angola -
MPLA) (12).
Au Forum social africain d’Addis-
Abeba en février 2003, un délégué du Congo-Brazzaville a pu estimer ironiquement
que deux légitimités s’affrontaient dans son pays : la « légitimité
démocratique » et la « légitimité pétrolière ». La
notion de recolonisation « civile » par le monde économique
international sied à cette situation. Et elle souligne clairement l’impuissance
de l’autorité publique en Afrique.
Sur ce continent, jamais il n’y a eu
autant de « batailles », de pathologies, de pillage de l’économie et
du sous-sol. Les profits accumulés ces quinze dernières années sont
considérables, voire inégalés. La réduction de l’aide publique au développement
livre les Etats à l’appétit des grandes firmes. De sorte que, dans bien des cas
de déstabilisation des régimes, les Etats européens se trouvent en complet
décalage, voire déphasés ou dépassés, par rapport à l’évolution des événements.
Et c’est donc toujours après coup qu’ils tentent de reprendre la main, notamment
par l’exercice d’une méthode éprouvée : la mise en place des
réconciliations nationales.
Dans la phase intermédiaire que
traverse l’Afrique, la résolution (provisoire) des conflits nécessite encore
l’intervention directe des Etats européens, dont les capitales ou les villes de
banlieue – symbole significatif, révélateur et illustratif – deviennent les
lieux de réconciliation des classes politiques africaines consacrant, de fait,
leur aliénation. Ainsi, les accords ivoiriens de Linas-Marcoussis, près de
Paris. Si les agents privés occidentaux et orientaux « allument » des
batailles et fomentent des coups d’Etat, il revient aux Etats occidentaux de
s’interposer entre les belligérants. Il y a là une complémentarité inadmissible
dans une odieuse division du travail.
Au total, les Etats africains se
trouvent de plus en plus fragilisés, – par le Fonds monétaire international
(FMI),
Il faudrait donc rechercher les
voies et moyens par lesquels les multinationales – comme les chefs d’Etat
et de guerre – impliquées dans des tentatives de déstabilisation pourraient être
traduites devant
Selon le mot de Hegel,
« l’histoire avance toujours par le mauvais côté ». Pour la
première fois sans doute apparaît, à travers les crises politiques actuelles, le
besoin réel de bâtir une nouvelle unité politique et économique de l’Afrique.
Celle-ci ne doit plus revêtir les vieux oripeaux de l’OUA et de l’Union
africaine ou les formes anciennes d’union économique telles
C’est l’éventualité d’une unité
réelle (et non plus chantée) du continent qui pourrait s’amorcer à partir de la
défaite historique des Etats africains. Et, dans ce désastre continu depuis cinq
siècles, les Africains n’ont pas la plus petite part de
responsabilité.
Pierre Franklin
Tavares
Politologue
(1) En 1990, lors du sommet
France-Afrique de
(2) Lire Sanou Mbaye, « L’Afrique noire face aux pièges du libéralisme »,
Le Monde diplomatique, juillet 2002.
(3) Lire Bruno Callies de Salies,
« Spectaculaire retour de la Libye », Le Monde
diplomatique, janvier 2001.
(4) Conférence des Nations unies pour
le commerce et le développement, « Les flux de capitaux et la croissance en
Afrique », Genève, juillet 2000.
(5) Rapport sur
le développement humain, 2003.
(6) Lire Anatole Ayissi, « Ordre politique et désordre militaire en
Afrique », Le Monde diplomatique,
janvier 2003.
(7) Lire Colette Braeckman, Les
Nouveaux Prédateurs. Politique des puissances en Afrique centrale, Fayard,
Paris, 2002.
(8) Lire Jean-Paul Ngoupandé,
L’Afrique sans
(9) Lire Alice Blondel, « Dérive
criminelle de l’industrie du bois », Le Monde diplomatique, décembre
2003.
(10) Lire Yves Ekoue Amaizo,
« Ce qui paralyse le pouvoir ivoirien », Le Monde
diplomatique, janvier 2003.
(11) Lire Frederic F. Clairmont,
« Ces firmes géantes qui se jouent des Etats », Le Monde
diplomatique, décembre 1999.
(12) Lire Olivier Vallée, « Elf,
au service de l’Etat français », Le Monde diplomatique,
avril 2000.
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/01/TAVARES/10927
3. Niger, un coup d’Etat de plus pour l’Afrique par
Mauricio D. Idrimi
Un autre coup d’Etat
vient d’avoir lieu en Afrique subsaharienne. Cette fois c’est au Niger, une des
nations les plus pauvres du continent africain et avec une institutionnalisation
républicaine très faible et non dépourvue de tensions intestines et de luttes
pour le pouvoir entre clans économiques et politiques. L’Union Européenne et les
Etats-Unis ont lancé un appel à l’ordre et au retour immédiat à « la vie
démocratique ». Ce que l’on sait actuellement est que le président Mamadou,
a été démis et tout le reste est incertain.
Les câbles et les
agences de nouvelles internationales nous informent que dans le courant du 18
février 2010 un coup d’État a triomphé dans Niamey, la ville capitale de Niger.
« Le président de Niger, de Mamadou Tandja, et ses ministres trouvent
retenus par les soldats insurgés qui ont fait, ce mardi, un coup d’État dans ce
pays africain », nous informe le journal espagnol El Païs. L’agence Reuters
ajoute que « le colonel Goukoye Abdul Karimou, porte-parole de
l’assemblée militaire autoproclamée Conseil Suprême pour
Mais qu’est-ce que
ça veut dire ? L’historique que l’on peut faire du Niger n’est pas
encourageante. Colonie française dès les XVIIIe et XIXe siècles, le pays obtient
l’indépendance de Paris dans la célèbre « Année de l’Afrique » pour
l’ONU le 3 août 1960. Hamani Diori a été son premier président, un pro
occidental dans l’ère bipolaire de guerre froide. Il a été déposé par des
militaires en 1974 sous le leadership de Seyni Kountché. Après quelques
tentatives manquées de coups d’État, en 1983, Kountché a formé un Conseil
Législatif des Ministres composé entièrement par des civils, présidé par Oumarou
Me Mana. Kountché mort en 1987, il a été remplacé par son allié, Ali
Seibou celui qui a consolidé sa position pendant les dernières années de
la décennie de 1980. Tout de suite se crée le puissant Mouvement National
pour le Développement Social qui se convertit en unique parti
légal.
On s’attendait
à ce que le Niger soit toujours dans de bonnes relations avec
Mais l’ordre
neoliberal, déjà imposé pour le long terme, s’est perpétué. Au
milieu de tout cela il y a eu une guerre civile non déclarée contre les Touareg
du nord du pays qui l’a dévasté de 1993à 1994. Le gouvernement
démocratique a alors été renversé en 1996 par un coup militaire dirigé par le
colonel Ibrahim Baré Mainassara qui s’est engagé à rendre le gouvernement aux
civils. Mamadou Tandja est arrivé sur le devant de la scène nationale du Niger
en décembre 1999 quand il a gagné les élections; il a été réélu en 2004 et
en 2009 il lui est venu l’idée de la réélection illimitée. Cela n’a pas plu à
l’occident pas plus qu’aux secteurs militaires conservateurs et l’establishment
de l’uranium. Aussitôt l’Union Européenne a appliqué des sanctions
économiques.
L’acharnement contre
Tandja avait beaucoup de motifs. L’agence Afrol News nous explique que
« jusqu’en 2009 Tandja disposait d’un
haut niveau de popularité et s’est fait connaître pour son engagement
dans le développement économique des pays appauvris. Aussi au plan
international, Tandja été apprécié pour sa présidence de
Mais l’Occident
avait des motifs plus urgents pour rendre la vie impossible au
gouvernement de Tandja, que de ne pas être un progressiste, il a voulu établir
d’autres relations internationales pour Niger. En juillet 2008, le
gouvernement de Tandja a signé un accord pétrolier très juteux avec
Le Niger est un
pays de plus de 12 millions d’habitants, dans leur majorité musulmans de la
branche sunnite (90%) vit un moment de grande incertitude et une autre fois
l’Occident contribue à son instabilité politique et joue
aux échecs à sa faveur. Entre les Xe et XIXe siècles, c’était un
foyer du royaume puissant Hausa; maintenant c’est une prise de la
globalisation occidentale qui change l’Afrique sous-saharienne en région la plus
instable et appauvrie de la planète.
Mauricio D. Idrimi est
membre d’AL UN DOS, un projet politique de communication alternative qui
intègre différentes expressions autour d’un axe central : l’étude de la
dette externe. En 2009 il a reçu le Prix National de Journalisme octroyé par
l’agence Télam par le Salvador Allende documentaire.
Chaque semaine ils animent un
programme de radio Al Dorso par FM Tribu, 88.7, les samedis de 13 à 15
hs. le premier samedi de mars 2010. www.aldorso.com.ar ils traiteront de ce sujet
Rebelion a publié cet article avec la permission de l’auteur, en respectant sa
liberté pour le publier dans d’autres sources (sources). Danielle Bleitrach en a
fait une rapide traduction pour changement de société
Rebelión, traduit par
Danielle Bleitrach
Source :
http://socio13.wordpress.com/2010/02/23/niger-un-coup-detat-de-plus-pour-lafrique-par-mauricio-d-idrimi/
Deux articles à lire du site www.aldorso.com.ar :
Un golpe más para Africa
África mía ¿50 años de deuda externa?
Tribune -
sangonet