
Bâtiment appelé couramment Building, abritant des Ministères, bombardé en 2003.
URSAD
Unité
de Recherche en Sciences Appliquées au Développement
=============
« Devise :
Vitesse dans le travail bien fait »
|
FRAGILITÉ
DE L'ETAT ET SOUS-DÉVELOPPEMENT EN CENTRAFRIQUE |
Présenté
par
Dieudonné
MOZOULOUA
Socio-anthropologue
Introduction
De tous les temps, la fragilité constante de l’Etat s’est révélée en Centrafrique comme un facteur majeur qui entrave le processus de développement de ce pays. Vécue au quotidien comme étant la faible capacité pour les pouvoirs publics d’assurer la cohésion, la cohérence et la consolidation des structures opérationnelles, la fragilité de l’Etat constitue une réalité récurrente favorisée par la distribution asymétrique des institutions étatiques sur le territoire national. Renforcée par le déficit chronique des ressources (humaines, matérielles et financières) disponibles, la répartition inadéquate des institutions publiques ne permet pas à l’Etat d’assurer une forte mobilisation des forces vives dans la mise en valeur des immenses potentialités du pays en vue de s’inscrire dans la dynamique de développement.
On assiste alors à une situation telle que la fragilité de l’Etat et le sous-développement font bon ménage et se nourrissent mutuellement. L’impasse sociale qui en résulte est très déplorable, favorisée par des décennies de crises économiques, politiques et militaires successives qui frappent de plein fouet le pays, en rendant ainsi irréversible l’instabilité des institutions de l’Etat en présence. Rien ne permet d'envisager une issue favorable de cette impasse en cette période cruciale où la fragilité accentuée de l’Etat aggrave le sous-développement.
Au regard de ce tableau très sombre, quelle compréhension peut-on en dégager, pour quelle piste d'orientation à envisager dans l'optique de sortie de ce cycle infernal de sous-développement qui est avant tout celui d’un l'Etat fragilisé?
C'est dans
ce cadre bien précis que la présente analyse entend aborder cette problématique
de portée éminemment stratégique, condamnée à faire l’objet d’un perpétuel
questionnement dans le but de contribuer autant que faire se peut à la quête des
pistes crédibles de solution pouvant déboucher sur le développement de
1. Les fragilités
politico-institutionnelles et politico-administratives
L’instabilité de l’Etat est si généralisée et si sévère qu’aucun secteur de la vie nationale n’est épargné, en commençant par les instances politico-institutionnelles et politico-administratives.
1.1. La fragilité politico-
institutionnelle
En Centrafrique la fragilité de l’Etat est très visible dans le mode d’organisation et de fonctionnement des institutions publiques, et reste liée à plusieurs facteurs qui s’intègrent parfaitement dans le système politico-institutionnel en place. L’un de ces facteurs majeurs est que l’accès et l’exercice du pouvoir répondent à d’autres critères que la compétence et le dévouement dans l’optique préconisée par le fondateur historique de la nation centrafricaine (Barthélemy Boganda). Au quel cas, la priorité accordée aux critères de complaisance dans la sélection des cadres se révèle sans surprise.
Dès lors, la construction des bases des structures étatiques repose depuis des années sur la conception qui perçoit finalement l’Etat comme un gâteau à partager entre les protagonistes de la classe politique en présence. Et que l’accès à un poste de pouvoir constitue une manière la plus sûre de prendre part active à ce partage. Cette conception qui met en parenthèse l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement au profit de la prédation, est incompatible au développement, à la stabilité et à la consolidation des appareils de l’Etat. On assiste à la pérennisation d’un système politique, comme un peu partout en Afrique centrale et subsaharienne, qui privilégie l’accumulation des intérêts immédiats individuels ou des groupes, sans lendemain pour le développement au détriment des intérêts stratégiques à long terme et au bien-être de la population. Du coup, la priorité accordée au triomphe des intérêts publics s’éclipse en même temps en laissant libre cours au déficit démocratique, à la mauvaise gouvernance, à la violation massive des droits humains, au conflits armés, au désengagement de l’Etat, à la privatisation, au paiement excessif de la dette extérieure et aux interférences néfastes des grandes puissances, des institutions financières internationales et des entreprises multinationales[1]
La vie politique se réduit ainsi aux activités électorales permettant la légitimation du partage du pouvoir qui se fait toujours au détriment de la population. Ainsi la configuration des institutions politiques répond plutôt au schéma imposé par les conditions de partage du gâteau qu’aux nécessités de développement. De sorte que la construction de l’Etat subit un coup fatal et se réalise en fonction des postures politiques adoptées par les acteurs en présence. Et que les changements des régimes ou les réaménagements des gouvernements qui en résultent obéissent plutôt aux contradictions internes à la classe politique qu’aux contradictions de la société globale, en se réitérant autant de fois que les mécontentements sont exprimés par l’une ou l’autre partie prenante au partage du gâteau. Lorsqu’on sait que les humeurs (liés à ces mécontentements) constituent des véritables leviers sur lesquels repose le fondement de l’Etat, on comprend assez rapidement qu’il suffit d’appuyer sur ces leviers pour basculer tout l’édifice. Dans cette condition la stabilité politique et institutionnelle n’est guère garantie, ni envisageable, sinon illusoire. On se trouve par contre dans un état maximum de menace permanente dans un cycle d’instabilité chronique solidement encrée dans la dynamique de fragilité des structures de l’Etat.
Tel est en réalité le cas de l’Etat en Centrafrique un demi siècle durant, caractérisé par les coups d’Etat, la dictature obscurantiste, les remaniements intempestifs des gouvernements, le pilotage à vue, l’absence des programmes de développement dans les domaines clés (comme l’industrialisation) et l’abandon des programmes en vigueur, les conflits socio-corporatifs, politiques, ethnicistes et militaristes.
Désormais, l’Etat se trouve alors confondu au déploiement des conflits et ou à leur résolution dans un cycle visiblement infernal, toujours renouvelé en frappant souvent au cœur des institutions de la république. Les sources qui alimentent ces conflits semblent intarissables ; les occasions de résolution de ces crises s’inscrivent, elles aussi, dans la même logique. Tenez, sur les dix dernières années, on a assisté à l’éclatement d’une série de conflits politico-militaires sous forme de mutineries au sein des Forces Armées Centrafricaines (FACA) pendant trois années consécutives (en 1996, 1997, 1998). Puis sont venus le coup d’Etat raté mais très sanglant (mai 2001), la tentative échouée de coup d’Etat et rébellion (en 2002) avant de se radicaliser par une guerre civile qui a finalement abouti au renversement du régime en place et à la prise du pouvoir par un autre (en 2003). L’avènement du nouveau régime ne signifiait nullement que le cycle était arrivé au bout du rouleau, car il a fallu quelques années seulement pour assister à l’éclatement de la guerre civile qui sévit sévèrement au nord du pays et qui fait l’objet des tractations de négociations actuelles.
Parlant
justement de spirale des négociations de la paix, il y a lieu de noter que
celles-ci ont proliféré autant de fois que éclatent et sévissent les conflits
qui les occasionnent. Contrairement aux engagements solennels des parties, aucun
n’est respecté, et on se sert continuellement des biens publics pour mobiliser
les parties, les témoins et les donateurs, mais sans résultats. On peut se
rappeler à ce sujet des fameux accords de Bangui négociés par Amadou Toumani
Touré, suivis de l’intervention des forces d’interposition dites neutres
dénommées Mission internationale de Surveillance des Accords de Bangui (MISAB en
1998), devenue plus tard Mission de Nations Unes en République Centrafricaine
(MINURCA en 2000). Toutes ces missions ont occasionné le déploiement à Bangui
des contingents militaires tchadiens, gabonais, congolais (de Brazzaville),
ivoiriens, camerounais et sénégalais, appuyés sur le plan logistique par les
troupes françaises sur les financements des Nations unies. Celles-ci étaient
représentées à l’occasion par un envoyé spécial du Secrétaire Général de l’ONU,
dont l'actuel Bureau des Nations unies en Centrafrique (BONUCA) constitue une
survivance. Violés après le départ de la mission onusienne, ces accords étaient
suivis des négociations de nouveaux accords politiques consécutifs aux
hostilités inhérentes au fameux coup d’Etat manqué du 28 mai 2001. Ensuite se
sont succédés les accords signés à la suite du compromis politique global obtenu
à l’occasion de la tenue du dialogue national (en 2003). Violés à leur tour en
présence des forces de
Cette réalité de chose est une reproduction fidèle de l’histoire
politique contemporaine de
Dans l’état actuel de la situation, rien ne permet de s’assurer que les accords qui sortiraient de ce forum politique en gestation (le dialogue politique inclusif), seraient respectés par les parties, afin de se consacrer au redressement de l’économie nationale du reste très fragilisée par ces différents conflits.
1. 2. La fragilité politico-administrative
La fragilité politico-administrative constitue un autre défi majeur pour l’Etat, qui tient à l’insuffisance de nombreux facteurs nécessaires à l’édification d’une administration publique performante et compétitive en tant que épine dorsale du déploiement de la puissance publique dans la conduite du destin national. En effet, l’administration publique centrafricaine est bâtie sur des ressources humaines peu évidentes du point de vue quantitatif et qualitatif. Bien que la fonction publique soit le plus grand débouché en matière d’emplois, les disponibilités d'offres de postes de travail sont en dessous des besoins. Il en va sans dire que l'administration publique souffre d’une situation défavorable liée aux problèmes de sous effectifs. A cela s’ajoute une contrainte essentielle reposant sur les valeurs intressèques de la plupart des fonctionnaires de l’administration publique. L’allusion est faite ici aux capacités techniques, aux compétences opérationnelles, à la motivation, à la conscience professionnelle, à la vision stratégique à long terme, à l’esprit d’initiative, de créativité et de dynamisme agissant, qui constituent, en toute état de cause, les véritables leviers d’une administration axée sur la culture du travail opiniâtre (bien fait) avec l’obligation des résultats, permettant d'accéder à la modernité. Le déficit sévère constaté à ce niveau non seulement empêche les services publics de tourner pleinement à haut débit, mais les inscrit également dans une dynamique qui évolue au contre-courant de l’histoire des sociétés modernes. Et si on prend en considération la complaisance dans les recrutements ainsi que les pratiques anomiques et harcelantes en prolifération effrénée, il y a lieu de craindre le pire dans l’avenir. Le pire, c’est entre autres la sous-administration du pays qui est déjà devant nos portes, et l’absence récurrente des services publics signalée sur de vastes espaces habités et inhabités renforcée par la recrudescence de l’insécurité dans ces zones entières laissées à la merci des bandes armées incontrôlées des coupeurs de routes (appelés communément zaraguina), des braconniers et autres malfrats de sinistre réputation qui ont pris le relais.
On assiste finalement à une répartition asymétrique de l’administration publique sur le territoire national avec une forte concentration dans les grandes agglomérations urbaines, notamment à Bangui plus précisément dans certains départements ministériels. Les postes administratifs situés à l’arrière pays font de plus en plus figure de formalité, et les nominations à ces postes sont transformées en débarras ou à la mise en garage des indésirables qui, une fois sur les lieux d’affectation, se contentent de la figuration passive. C’est le moment propice de tourner les pouces et de violation flagrante des horaires de travail par les retards, absences, sorties intempestives, abandon de postes de travail avant la fin de l’heure, etc. L’alcoolisme pratiqué autour des repas assortis de bavardages creux, sont devenus des substituts aux activités professionnelles. Dans les villes comme Bouar, Berberati Nola, etc., (chefs-lieux des préfectures situées au nord-ouest du pays), l’expression «aller sur le terrain» est consacrée par les cadres de la fonction publique pour désigner leur présence dans les gargotes (ou buvettes ou Nganda) pendant les heures de travail, ou parmi les administrés à des fins de tracasserie et d’extorsion.
Il
convient de souligner à ce niveau que ces pratiques ne sont pas l’apanage de
l’administration préfectorale, loin s’en faut, elles sont également fréquentes
appliquées avec la même intensité dans les services publics de la capitale, sous
le regard indifférent et impuissant des autorités gouvernementales et des
directions centrales. A Bangui, la présence des cadres de la fonction publique
est signalée dans les bureaux entre 9 heures et 11 heures, au-delà il faut les
retrouver dans les buvettes pour boire, manger, bavarder et téléphoner en
attendant la fin de l’heure. Les bureaux sont ainsi abandonnés à la merci des
secrétaires et personnels d’appui qui passent leur temps à causer au téléphone
de bureaux, à jouer à la carte sur les ordinateurs, à se raconter de petites
histoires relevant des faits divers avant de fermer les portes à quelques heures
de la fin de l’heure officielle. Malgré la décision n°002 du 29 novembre 2006 du
Président de
Ces
faiblesses d’ordre organisationnel et fonctionnel d’une administration dotée en
ressources humaines insuffisantes, sont renforcées par le déficit matériel au
sens le plus large du terme. Le peu de matériels existants sont concentrés entre
les mains des cadres appartenant aux sommets stratégiques à des fins liées aux
fonctions (ostentatoires), au détriment des technostructures et des bases
opérationnelles qui en plus besoin mais se contentent dans les meilleurs des
cas, de la vieillerie. En provinces la situation est pire, ce qui ne permet pas
de couvrir le territoire national dans son ensemble en vue de s’assurer de la
situation exacte dans chaque domaine d’activités. Au bureau de
Outre ce qui précède, les infrastructures qui abritent l’administration publique constituent un autre goulot d’étranglement. La quasi-totalité de celles-ci sont l’héritage du régime colonial (90%), devenue de nos jours vieillissantes, délabrées et en ruine. Leur réhabilitation se fait de plus en plus rare et se limite au renouvellement de la peinture, la construction de nouvelles infrastructures non seulement se raréfie, mais se contente simplement de bâtiments exigus traduisant la réalité d’un système administratif sans ambition et attentiste (assujettie par une idéologie tronquée de salariat sans contre-valeurs en terme de travail réel fourni et d’espoir sur les financements extérieurs). Le niveau de laxisme est si élevé que les flaques d’eau, la boue et l’herbe ont fini par envahir certains ministères (à Bangui), des centres administratifs (à Nola), des directions et services un peu partout dans le pays. La plupart de ces infrastructures fonctionnent sans conditions minimum de travail, sans eaux, sans électricité, ni toilettes, ni le moindre confort. Cette image est une illustration de l’état de dégradation avancé des infrastructures administratives.

Bâtiment appelé couramment
Building, abritant des Ministères, bombardé en 2003.
Les résultats qui en découlent sont dramatiques au point que l’administration publique est devenue partisane, inféodée aux humeurs des animateurs en présence. Le spectre du sentiment ethnique (le phénomène de «mara» ou ethnie d’appartenance de triste célébrité) est très visible, tout comme les références aux affinités, appartenances et origines. La lenteur dans le traitement des dossiers est monnaie courante, la rétention et l’égarement des dossiers sont des véritables entorses qui gangrènent son fonctionnement. On se retrouve alors en face d’une machine administrative sans repères, moins performante et incapable de mobiliser et canaliser les énergies vers la modernité.
2. Les fragilités politico-économiques et
politico-stratégiques
L’instabilité ci-dessus déplorée se répercute sur une situation très fragile vécue tant sur le plan politique-économique que politico-stratégique.
2.1. Les fragilités
politico-économiques
A l’instar du régime politique en vigueur, le système économique en place fonctionne sur les bases héritées de la colonisation caractérisée par des contradictions structurelles graves, marquées par une rupture nette entre ses secteurs classiques. Le principal goulot d’étranglement se situe au niveau de fonctionnement embryonnaire du tissu industriel qui n’avait pas accordé la priorité au secteur agro-alimentaire qui allait coïncider mieux avec les potentiels incommensurables en terme des ressources agro-alimentaires du pays. L’Etat n’a jamais réussi à surmonter ce clivage qui repose depuis des décennies sur un système économique réduit aux fonctions traditionnelles, basées essentiellement sur le prélèvement des impôts et taxes ainsi que des frais de douane pour payer le salaires des fonctionnaires, la bourse des étudiants et les pansions aux retraités.
Ce prélèvement s’accompli comme une simple fonction de routine au mépris des investissements (dans l’agriculture et l’industrie) et la mise en valeur des ressources dans tous les secteurs, véritables activités créatrices de la richesse à forte valeur ajoutée.
Longtemps basé sur l’exploitation des cultures de rente (coton, café, tabac), le secteur agricole présente des signes d’essoufflement évidents suite à la détérioration des cours des matières premières sur le marché international et à l’absence de politique interne de régulation des prix comme en Côte d’Ivoire. Du coup, la production de coton (culture de rente phare) a connu une chute vertigineuse de 400 mille tonnes dans les années 70 et 80, à 35 et 40 mille tonnes ces dernières années. Le secteur vivrier jamais organisé véritablement, est resté à l’état rudimentaire à très faible rendement utilisant des circuits fragmentaires et informels sans impact significatif sur le fonctionnement de l’économie nationale et sur la satisfaction des besoins alimentaires exprimés par la population. Sur 3,8 millions de têtes de cheptel bovin, on a connu une perte d’environ 800 mille bêtes suite à l’insécurité, les maladies et l’exode des éleveurs Peuls au Cameroun, au Nigeria et en RDCongo (avec environ 40 mille bœufs sortis du pays) en laissant dernière eux 16 millions d’hectares de pâturage pouvant contenir 10 à 20 millions de bêtes. Le déficit de la production agricole est si considérable que le coton a perdu sa place de premier produit d’exportation au profit du bois, du diamant et de l’or, dont l’incidence financière sur le budget national ne se vérifie qu’à peine.
Le secteur commercial tourne au ralenti à cause des contraintes d’enclavement (géographique et mental)[2], de dévaluation du Francs CFA, d’instabilité politique et de l’Etat, renforcé par la crise pétrolière récente et la crise financière internationale actuelle.
Sur le
plan macro-économique, les mêmes indicateurs reviennent à chaque analyse de la
situation dont voici les caractéristiques essentielles : déficit
budgétaire, faible production, finances publiques dérisoires, dette publique
exorbitante (pays moins avancé très endetté : PMAE), balance commerciale
déficitaire, PIB faible (environ 250 $), épargne insignifiante, faible
croissance, etc. Les indicateurs
sont en rouge et n’augurent aucune chance d’amélioration, en tout cas pas
à moyen terme. Ce qui condamne
Dans ce contexte marqué par une économie totalement sinistrée (sauf la spéculation autour du prélèvement des prierres précieuses), la survie quotidienne de la majorité de la population ne tient qu’à quelques ficelles, celles proposées par le secteur informel. Ce dernier qui ne présente que des signes timides d’évolution, n’arrive pas à s’éclore véritablement pour se libérer d’une culture de laxisme et de moindre effort très encrée dans les mœurs, et qui se traduit par ce qu’il conviendrait d’appeler ici «la maladie de petits chiffres» et de petites réalisations, érigée en objectifs de développement (mais de quel développement ?) au détriment des visées basées sur les grandes ambitions propres à l’esprit camerounais. La prolifération des taxes, impôts, frais de douane, des tracasseries de toutes sortes (administrative, policière, militaire, individuelle), constitue une entrave majeure à l’épanouissement de ce secteur vital qui emploie plus de 60% de la population active en milieux urbains. Lorsqu’on ajoute les braquages, l’insécurité et l’extorsion pratiquée par les coupeurs des routes (zaraguina), on comprend très vite qu’il faut absolument assez de temps pour espérer un essor réel de ce secteur qui a donné des preuves évidentes de maturité ailleurs en tant que alternative crédible à la faillite de l’économie officielle. Il n’en résulte pas moins que le secteur informel, à l’image de ce dernier, est loin de servir de point d’appui à la croissance. En plus, les principaux leviers économiques opérationnels sont contrôlés en amont par les opérateurs étrangers ou naturalisés : élevage bovin, industries légères, commerce d’or, de diamant et de bois, transport, commerce en gros et en détail, etc. La majorité des natifs se contentent en aval du rôle de consommateurs. D’où, la quasi-totalité des produits de première nécessité, agricole et ou manufacturiers, sont importés de l’étranger, en commençant par les pays de la sous-région d’Afrique centrale notamment le Cameroun, le Congo (RDC), le Tchad et même le Congo Brazzaville.
Devant cette situation déplorable, l’Etat assiste impuissant en dépit de quelques tentatives timides et ne parvient pas à se doter suffisamment de ressources permettant de se ressaisir pour restaurer la cohésion entre les trois dimensions fondamentales d’une économie dynamique en pleine expansion, à savoir la production, la transformation et la redistribution du produit social. C’est la seule alternative crédible qui s’offre pour sortir le système économique centrafricain des pratiques mercantilistes actuelles axées sur le prélèvement naturel (exportation des grumes et pierre précieuses brutes) pour en faire un véritable instrument de développement, essentiellement centré sur l’amélioration des conditions de vie de la population, surtout les couches paupérisées. En stigmatisant le laxisme des Etats en Afrique, Mildred Kiconco Barya a relevé qu’en 1965, Singapour avait le même PNB que l’Ouganda. Le premier ministre de Singapour a canalisé les comportements des populations vers des actions positives et maintenant Singapour est parmi les nations les plus développées[4]. Ce qui est loin des préoccupations de l’Etat en Centrafrique, du moins dans le contexte actuel, et les répercutions sur la vie nationale sont fatales.
On assiste de ce point de vue ces dernières décennies, à une succession des équipes gouvernementales sans programme de développement cohérent et précis. Ceux qui sont mis en œuvre sont pour la plupart conçus de l’extérieur notamment par les agences de coopération internationale du nord et s’avèrent souvent inopérants parce qu’inappropriés. Les fonds engagés dans ces programmes sont engloutis à 80% dans les aspects liés au fonctionnement au détriment des activités réelles des projets. Les privilèges accordés aux malversations et opérations retour finissent par volatiliser l’essentiel des financements. On comprends alors très rapidement que dans un tel contexte les investissements stimulant les secteurs productifs des richesses ne sont pas inscrits dans l’agenda de mise en route des politiques de développement économique. Ce qui entraîne à la ruine l’ensemble du secteur agricole, le piétinement de l’industrie légère en gestation et de l’embryon du secteur artisanal, avec des restrictions drastiques sur le commerce intérieur et international qui en souffrent terriblement, en plus des tracasseries et l’insécurité ci-dessus évoquées. Ces pratiques aux effets défavorables sur les avoirs de l’Etat, ont finalement réduit ceux-ci aux collectes des redevances publiques (30% du budget national) et à l’aide internationale (70% du budget national). L’action gouvernementale se résume ainsi à une triade de réalisations devenue classique en Centrafrique comme obligation de l’Etat, à savoir la paie des salaires de la fonction publique, des bourses d’études et des pensions de retraite, au point qu’elle s’est érigée en un véritable projet de société et programme politique pour les gouvernements qui se succèdent, pour les acteurs politiques (du pouvoir et de l’opposition) et finalement acceptée (légitimée) comme tel par l’ensemble de la population. La pauvreté qui en résulte conduit à un phénomène bizarre, ce que le débat politique polarise l’attention de tout un peuple, en plus de la focalisation de la redistribution du pouvoir à quelques institutions publiques à Bangui au détriment de l’arrière pays, avec une incidence grave sur la stabilité et la sécurité de l’Etat.
2.2. Les fragilités
politico-stratégiques
Le déficit
de l’Etat à relever les défis a servi de déclic pour jeter les mécontents dans
la nature, et comme cette dernière a horreur du vide, l’absence de l’Etat
(notamment de l’administration, de la gendarmerie et de l’armée) sur de vastes
étendues du pays a laissé libre cours à l’émergence des phénomènes indésirables
et incompatibles à la paix, à la stabilité et à la sécurité publique. On a assisté à la résurgence des bandes
incontrôlées (coupeurs de routes, braconniers, braqueurs) et aux forces armées
d’insurrection qui ont connu très vite une recrudescence à la faveur de la
prolifération des armes à feu en circulation occasionnée par les multiples
conflits armés qui secouent la sous-région d’Afrique centrale. La stabilité de
l’Etat déjà précaire s’est retrouvée sérieusement détériorée et la sécurité
compromise, se manifestant concrètement par les exactions, les séquestrations et
les règlements de comptes, les assassinats des autorités préfectorales et
locales, les affrontements armés violents entre les forces belligérantes,
l’occupation d’une partie du territoire national par les insurgés, etc. Les
dégâts sont souvent considérables dans tous les cas et s’évaluent à plusieurs
milliers des morts, des blessés, des malades et invalides dus aux conflits. Il
faut ajouter à cela les déplacés de guerre et les réfugiés, sans compter les
pertes sur les plans matériel et financier. Face à l’ampleur de ces événements
et l’incapacité de l’Etat à imposer la paix, l’implication des armées
étrangères (des pays de
3. Les fragilités politico-culturelles
et sociale
La fragilité constatée à ces différents niveaux de l’Etat fait payer un lourd tribut à tout un peuple assez meurtri qui a fini par développer un complexe comportemental visiblement atypique, tout aussi fragile sur le plan aussi bien politico-culturel et politico-social.
3.1. La fragilité
politico-culturelle
Harcelée par les hostilités récurrentes et lâchées par un Etat en perte de vitesse, la population centrafricaine a fini par développer un mode de vie qui reflète la configuration sociale en vigueur marquée par un degré élevé de violence.
En effet, la perte des repères qui résulte de cette instabilité a engendré la culture de violence se manifestant dans la vie pratique par des multiples clivages. On se trouve alors en présence d’une spirale dont les maillons en parfaite interaction sont auto-entretenus et alimentés chaque fois par les crises successives qui secouent le pays. On assiste alors à l’émergence d’une espèce de complexe de violence exprimé au quotidien par les clivages ethniques, politiques, communautaires (nordistes et sudistes notamment entre les ressortissants de deux ethnies dominantes proches du pouvoir), qui étouffent les véritables clivages entre les classes sociales des privilégiés et des appauvris. Les dérapages qui en découlent sont énormes et prennent parfois des tournures imprévisibles, débouchant sur les clivages (et la violence) entre les personnes de sexes différents (les femmes battues), les générations, les individus (les bagarres fréquentes de quartiers et de rues), voire entre les communautés étrangères établies en RCA (Congolais : RD Congo, Tchadiens, Peuls, etc.). Celles-ci sont violemment prises à partie, à tort ou à raison, souvent par prétexte, pendant des mécontents populaires ou sur l’initiative malveillante de certains groupuscules. Le cas des cireurs congolais associés aux fameux Banyamoulengué (pseudonyme désignant les rebelles de MLC de J.P. Bemba de triste mémoire), des commerçants détaillants Tchadiens assimilés aux Zaraguina et des éleveurs Peuls du nord-est et centre-ouest du pays est très symptomatique. Ce complexe de violence a fini par développer chez les Centrafricains l’esprit exacerbé de destruction et de pillage des infrastructures publiques de base, des magasins et entreprises, en emportant parfois jusqu’aux dernières briques et pierres des fondations, croyant avoir réglé des comptes à la pauvreté liée aux injustices sociales et à la paraisse des personnes. On s’inscrit alors dans un cercle vicieux où la violence et la pauvreté font bon ménage, se nourrissent et s’entretiennent mutuellement.
C’est pourquoi les Centrafricains n’ont visiblement pas encore eu le
temps de s’investir sérieusement dans le travail productif générateur de la
richesse à forte valeur ajoutée. Comme l’a fait remarqué un acteur avisé de la
société civile, on ne prend pas le temps de relever les multiples défis liés aux
incidences perverses du programme d’ajustement structurel (PAS), de la
dévaluation de Francs CFA, des dérives dictatoriales, de l’échec de la du
multipartisme pseudo-démocratique, des conflits fratricides, de la crise
pétrolière et financière internationale. Bref, du sous-développement qui
embrigade une population plongée au seuil le plus profond de la précarité. On se
livre plutôt à coeur joie à une espèce d’autosatisfaction collective
complaisante, croyant que l’on fait toujours bien et qu’on est en bonne
position, alors qu’en réalité on se trouve largement en retard par rapport aux
autres pays de la sous-région, fin de citation. Ce complexe, mieux cette
apothéose de la violence auréolée par le culte de la médiocrité, qui condamne
Les principales victimes se recrutent parmi les ambitieux au sein des familles, des quartiers, des services administratifs, des établissements scolaires, supérieurs et universitaires, des entreprises et des organisations sportives et de développement, des associations à assise communautaire ainsi que dans les milieux d’affaires. Les rescapés de ce fléau ne trouvent leur salut que dans la dissimilation du zèle et de l’enthousiasme dans le travail bien fait, du courage et de l’ambition ainsi que des avoirs (matériels et financiers) et du savoir, pour vivre comme tout le monde. Dans cette condition l’échec est devenu une règle d’or et la réussite une exception, sinon une denrée rare mais qui suscite toujours des agacements chez les tenants de la ligne dure de cette forme d’intolérance.
L’impasse qui en résulte est sans surprise et s’étend sur tous les
secteurs de la vie nationale, notamment dans les domaines d'infrastructures
socio-économiques de base (routes,
ports, aéroports, ponts, usines, institutions d’enseignement, etc.). Ce qui
prédispose tout le pays à deux postures rétrogrades à savoir l’attentisme et la
dépendance extérieure, singulièrement vis-à-vis de
3.2 La fragilité
politico-sociale
De ce qui précède, il s’ensuit que les répercutions sont fatales sur la vie sociale, dans la mesure où la majorité de la population est plongée dans une situation de précarité indescriptible, difficile à décrire intégralement dans le cadre restreint de cette analyse critique.
Mais on peut se contenter tout de même de quelques aspects les plus saillants pour signaler les multiples restrictions qui entravent considérablement l’accès à la nourriture au quotidien pour la plupart des ménages où on se contente souvent, dans les meilleurs des cas, d’une tasse (en plastic grossier) de café noir avec deux beignets à base de farine de blé. Et le soir d’un repas à base de légumes locales mélangées aux champignons sauvages comestibles frais ou séchés ou aux chenilles accompagnées de la pâte omniprésente de manioc (l’aliment de base pour toutes les tranches d’âges et les catégories sociales). Cette situation déplorable met en péril l’état nutritionnel qui se caractérise par un taux élevé de malnutris et de sous-alimentés, surtout chez les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes âgées et invalides ainsi que les malades.
Dans le
même ordre d’idée, l’accès à l’eau (tout court) et plus précisément à l’eau
potable, est un véritable calvaire pour la population et représente entre 10 à
15 % seulement pour le pays et 25 à
30 % à Bangui. Le réseau de
L’accès à
l’électricité offre le même spectacle au quotidien qui se traduit par une
restriction systématique de la consommation d’énergie. En effet, le taux de
consommation d’électricité était de 5 % dans le pays et de 15 % à Bangui au
cours de la deuxième moitié de la décennie précédente. Avec l’essoufflement des
dispositifs techniques de l’Entreprise Nationale d’Electricité de
Les restrictions vécues à ces différents niveaux (accès à la nourriture, à l’eau et à l’électricité) sont révélatrices des conditions de vie précaires et sources de graves problèmes de santé qui se posent avec acuité. Le système de santé a montré aussi des signes évidents d’essoufflement à tous les niveaux (central, intermédiaire, périphérique) et tourne également au ralenti. Les infrastructures qui remontent pour la plupart de l’époque coloniale (autour de 1940), sont visiblement en état de ruine avancé. Les capacités d’accueil réduites à leur plus petite expression sont en inadéquation criante avec une demande de plus en plus croissante liée à la croissance démographique. Les extensions apparaissent dérisoires et posent un problème réel d’équilibre entre l’offre et la demande des soins de santé. Malgré l’introduction d’une approche novatrice basée sur les soins de santé primaires, la couverture sanitaire demeure inférieure aux besoins exprimés à cause de déséquilibre flagrant de ratio médecin-malade (1 sur 100 mille) et des faibles effectifs du personnel médical. A cela s’ajoutent les irrégularités récurrentes d’approvisionnements en médicaments en dépit de l'introduction des génériques, la mauvaise qualité du matériel médical, le déficit de motivation lié aux conditions médiocres de travail, l’inconséquence des politiques sanitaires, les pratiques peu conformes à la déontologie médicale et l’insécurité qui sévit dans le pays (avec ses actes de vandalisme). Ce qui fait que le système de santé est devenu en lui-même un problème de santé publique en Centrafrique.
L’insalubrité de l’habitat, le logement précaire, la prolifération des vecteurs (moustiques, mouches, cancrelats, petits reptiles, batraciens, mouches tsé-tsé, etc.), la pollution des eaux, la poussière, la recrudescence de la consommation de tabac (à fumer et à priser), constituent d’autres problèmes cruciaux de santé publique. Dans ce contexte visiblement confus le paludisme est élevé au premier rang des causes principales de consultation, d’hospitalisation et de mortalité et représente en lui-même 40 % environ de taux de létalité (selon les sources officielles), surtout chez les enfants de 0 à 5 ans. On assiste aussi à la résurgence de certaines maladies naguère disparues ou en voie d’instinction comme la trypanosomiase africaine.
Associée
aux dégâts socio-sanitaires de la guerre, cette situation pour le moins
catastrophique fait de
4. Les enjeux et
perspectives
A la
lumière de ce qui précède, il y a lieu de se s’interroger sur ce qui peut être
les véritables enjeux, ou si l’on veut les enjeux réalistes et les signes de
temps sur qui reposent les perspectives d’un avenir radieux pour
4.1. Les enjeux de développement de
Comme partout ailleurs où le progrès est devenu un fait accompli, le
développement de
Cette thèse essentielle pleine de signification et d'enjeux historiques,
sociologiques et stratégiques, soulève une préoccupation fondamentale non encore
résolue pour
Pour
4.2. Les perspectives d’avenir
Quoi qu’il en soit, il y a toujours lieu d’espérer en un avenir glorieux
de
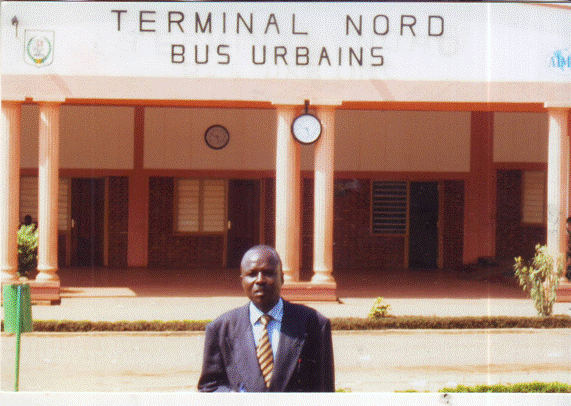
Bâtiment abritant le terminus des bus, construit par le
Maire de la ville de Bangui en 2008.
Une telle dynamique est propice à l’émergence d’une conscience collective axée sur les vertus du travail et préfigure un changement réel des mentalités et des comportements à tous les niveaux, en commençant par les institutions publiques, dans l’optique de l’amorce de la réforme en profondeur des structures de l’Etat, en vue de la restauration de la paix, la stabilité, la sécurité et la relance du développement.
Conclusion
Au terme de cette modeste réflexion d’intérêt hautement stratégique sur
le devenir de ce pays, il y a lieu de noter que la fragilité récurrente de
l’Etat constitue une entrave déterminante pour le développement de
Il est évident que tous les aspects ne sont pas abordés, mais l’étude
offre une vision panoramique de la situation de sous-développement dans laquelle
se trouve
Pour sortir de cette ornière, plusieurs pistes de solution sont
envisageables, mais dans le cadre de la présente étude il parait plus judicieux
de privilégier celles qui font appel aux expériences pratiques pour bâtir les
perspectives réalistes sur l’avenir du pays. Pour ce faire,
BIBLIOGRAPHIE
- KALELE -ka-BILA. Le sous-développement de l’Afrique et la philosophie de lutte contre les meilleurs, LABOSSA, Lubumbashi, 1992.
- KICONCO BARYA M. Sciences sociales et l’avenir de l’Afrique, CODESRIA, Dakar, 2005
- MOZOULOUA
D. Accès à la mer, un défi à variables multiples pour
- PNUD. Rapport mondial sur le développement en 2005, Economica, Paris, 2005.
- NATIONS UNIES. Central African Republic. Consolidated appeal, 2008.
[1] KICONCO BARYA M. Sciences sociales et l’avenir de l’Afrique, éd. CODESRIA, Dakar, 2005, p. 1O7.
[2]MOZOULOUA D. Accès à la mer, un défi à variables multiples pour
[3]PNUD. Rapport mondial sur le développement en 2005, Economica, Paris, 2005, pp. 376-383.
[4]KICONCO BARYA M, op. cit. pp.
107-108.
[5]KALELE -Ka-BILA. Le sous-développement de l’Afrique et la philosophie de lutte contre les meilleurs, LABOSSA, Lubumbashi, 1992.
[6]NATIONS UNIES.
URSAD
O N
G
B.P. 607 Direction,
Cité Jean XXIII, Bangui-RCA, Tél. 00 (236) 70 40 28 18, Mail : ursad_ursad@yahoo.fr
__________________________________________
Nous
vivons en République Centrafricaine une période de crise aigue qui touche tous
les secteurs de la vie nationale. Les secteurs économique et social sont
particulièrement plus affectés. La conséquence en est que la majorité de la
population est reléguée en dessous
du seuil de la pauvreté. La précarité des conditions de vie qui en résulte est
sans égal, et constitue, en tout état de cause, une interpellation pour une
prise de conscience des acteurs avisés en vue d’une mobilisation débouchant sur
les actions de développement à la base. Mais la mise en œuvre des celles-ci
requiert une démarche éclairée reposant sur des études préalables des situations
concrètes, permettant une bonne connaissance des réalités du terrain afin
d'envisager les solutions adaptées aux attentes des
demandeurs.
C’est
dans cette optique que URSAD a pris
l’engagement pour la mise en œuvre
des initiatives
visant l’amélioration des conditions de vie des communautés de base. Elle s’appuie dans sa démarche sur les résultats de la
recherche sur les cas précis, afin de bien conduire les actions de
développement.
2. Objectifs du
centre
Dans l’accomplissement de ses activités
URSAD poursuit les objectifs
suivants :
1.
Mener des études de
terrain dans l’optique de la recherche-action et de la
recherche-développement.
2.
Initier et conduire
des actions de développement à la base
3.
Appuyer les
communautés de base dans la mise en œuvre des activités de développement à
assise communautaire.
4.
Capitaliser et
valoriser les résultats des recherches et des activités de terrain sur des
supports écrits, virtuels et audiovisuels.
3. Domaines
d’action
Les domaines d’action
concernés par les activités de URSAD
sont multiples, étant donné l’option pluridisciplinaire de sa vocation.
Néanmoins les secteurs qui focalisent actuellement l’attention du centre sont
les suivants :
-
La
pharmacopée et la médecine traditionnelles africaines.
-
L’agriculture vivrière
(variétés locales).
-
L’environnement et la
biodiversité (les éco espèces des zones tropicales
humides).
-
La
nutrition (basée sur les denrées alimentaires
locales).
-
La
lutte contre le paludisme Falciparum.
-
La
lutte contre la pauvreté
-
Le
genre, développement et appui-conseil aux organisations
féminines
-
La
sédentarisation des peuples pygmées de Centrafrique
-
La
lutte antitabac
-
Les
changements climatiques, énergies renouvelables et ressources en
eau.
4. Domaines de
compétences
Les experts de URSAD
disposent des compétences dans les domaines ci-après :
-
Systématique et
taxonomie végétales (espèces de forêts et savanes
tropicales)
-
Ecologie et
aménagement des écosystèmes (dynamique forêt-savane)
-
Approches de médecine
traditionnelle
-
Méthodologie de
recherche en sciences sociales
-
Appui-conseil aux
organisations communautaires de base et aux activités de
développement
-
Techniques agricoles
améliorées
-
Formation
-
Encadrement du
processus de sédentarisation et d'intégration des peuples
pygmées
-
Rédaction des travaux
scientifiques
-
Mise
en oeuvre des cycles de projets.
5. Structuration du
centre
URSAD s’appuie
essentiellement sur cinq piliers :
-
un
Directeur
-
un
Coordonnateur
-
un
Secrétaire Général
-
deux
Responsables de volets spécifiques
6. Fonctionnement du
centre
Les responsabilités au
sein du bureau du centre sont assurées de la manière
suivante :
1. le Directeur :
chargé de volet environne ment et biodiversité.
2. le Coordonnateur:
chargé de volet médecine traditionnelle africaine, appui au développement, lutte
contre la pauvreté, Sédentarisation des Pygmées.
1. un Responsable de
volet biomédical et phytosanitaire
2. un Responsable de
volet agro-alimentaire, genre et appui-conseil aux organisations féminines.
Outre ces acteurs,
l’URSAD bénéficie également du
concours ponctuel des consultants sollicités en fonction de besoins du centre et
de qualifications de ces intervenants extérieurs. Le centre encourage vivement
les candidatures féminines. Il
bénéficie également de l’appui de cinq conseillers. Il
s’agit de :
-
un
conseiller scientifique
-
deux
conseillers techniques
-
d’un
conseiller médical
-
d’un
conseiller juridique.
Dans la mise en oeuvre
des actions de terrain, URSAD
privilégie une vision spécifique et originale, axée sur l’étude préalable des
problèmes réels en vue d’une connaissance correcte des besoins exprimés par les
populations. Elle met en avant la démarche qui fait appel à la
recherche-développement, basée essentiellement sur l’approche participative et
communautaire. Il s’agit là d’un ensemble des pratiques concrètes recourant aux
initiatives locales en vue d’améliorer les conditions de vie des populations,
par les populations et pour les populations
8. Philosophie de
travail
Les actions
de URSAD reposent sur une vision simple mais très essentielle pour le
développement. Elle porte sur trois fonctions humaines fondamentales en
développement, à savoir
-
La réflexion permet d’entrevoir des activités adaptées aux besoins réels de la
population.
-
La parole sert à persuader et à mobiliser les acteurs et les moyens
nécessaires.
-
L’action permet de transformer et d’améliorer les conditions de vie des
bénéficiaires par les résultats du travail.
9. Site
d’intervention
A
part les interventions ponctuelles, URSAD a créé un Site Agro-pastoral Expérimental de
Sebala (SAPES), situé à
10.
Partenaires
Actuellement URSAD traite avec les partenaires tant
institutionnels qu’individuels aussi bien au niveau africain qu’en dehors du
continent. Elle collabore avec :
-
Ministère de la santé
et de la population
-
CEMAC
(Siège de Bangui)
-
CAMES:
programme de pharmacopée et médecine traditionnelles africaines (Burkina
Faso),
-
le
réseau ReMed (institution : France)
-
GFMER
(Genève / Suisse),
-
IMPACT
(Cotonou/Bénin).
-
FNTCA
(Siège Bangui RCA)
11. Personnes de
Contact.
1. Equipe permanente
URSAD
-
Directeur :
Roger
APEMA
Mail : apema_roger@yahoo.fr
-
Coordonnateur :
Dieud.
MOZOULOUA, Mail : mozulua@yahoo.fr
2
En Afrique
Afrique du
nord : Professeur
El
RHAFFARI
(botaniste), Laboratoire de
valorisation et préservation des plantes Médicinales et
Aromatiques
des Zones Arides et Semi-arides. Faculté des Sciences et Techniques. Errachidia.
Maroc. Errachidia, Tél.
:
21255574497 21261503145. Fax : 21255574484/85, Mail :
elrhaffari@yahoo.fr
Site web : http://site.voila.fr/Phytaromaosis
Afrique centrale et de
l’ouest:
Professeur
Jean
KOUDOU
(chimiste),
Mail :
jean_koudou@yahoo.fr
3. En
Europe
Suisse : Professeur
Aldo CAMPANA (Médecin, chirurgien),
Mail :
Aldo.Campana@gfmer.ch
site
web : http://www.gfmer.ch
France : Mr. Rémi J. VASSEUR
: Ancien conseiller en
protection sociale internationale, Spécialiste en Prévention Santé et techniques
naturelles de soins, Educateur en Bien-Etre
Alimentaire
Mail :
remij.vasseur@wanadoo.fr
4. En Amérique du
nord
USA : Professeur
Georges NZONGOLA
TALAJA (Politologue),
Fax : 4722 122701, Tel. 47-22.12.27.05 (direct) or 22.12.27.00, Fax: 47-22.12.27.01, Mobile:
47-95.77.75.06, E-mail: georges.nzongola-talaja@undp.org
_______________________________
Dernière actualisation d’avril
2009
Diffusion : URSAD / sangonet.com